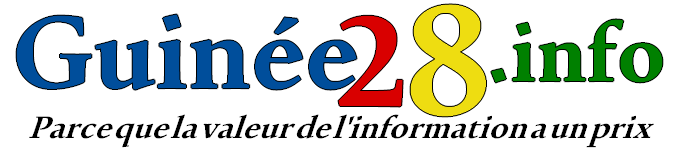Une révolution silencieuse se dessine dans le paysage financier mondial, mais de nombreux dirigeants d’entreprises africains semblent négliger les avertissements. Thierno Mohamadou Diallo, enseignant-chercheur à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, souligne que l’Afrique demeure fortement dépendante du dollar américain pour ses échanges, ses réserves et son endettement, alors que le système du pétro-dollar montre des signes de déclin. Avec la montée en puissance de pays comme la Russie et la Chine, qui remettent en question le monopole du dollar, les nations africaines doivent adapter leur stratégie économique pour s’insérer dans un monde financier multipolaire. Cette évolution constitue à la fois un défi et une occasion d’accélérer la diversification monétaire et l’intégration régionale. Lisez !
Il se déroule une révolution silencieuse dans la finance mondiale, et nombre de dirigeants d’entreprises africains n’en ont pas encore perçu les signaux. Alors même que le continent reste profondément arrimé au dollar américain pour le commerce, l’épargne et l’endettement extérieur, le socle même de cette dépendance — le système du pétro-dollar — commence à s’effondrer.
Pendant des décennies, le dollar a régné en maître absolu. Sa domination mondiale est restée incontestée, consolidée par une manœuvre géopolitique magistrale conçue dans les années 1970 : le pétrole, la marchandise la plus stratégique du monde, serait désormais exclusivement libellé en dollars américains. Cet accord entre les États-Unis et l’Arabie saoudite — répliqué à travers le bloc de l’OPEP — a donné naissance au système du pétro-dollar, une architecture économique qui a contraint chaque pays, indépendamment de sa géographie ou de son idéologie, à détenir d’importantes réserves de devises américaines, simplement pour assurer le fonctionnement de leurs secteurs énergétiques.
Ce fut un coup de génie — positionnant le dollar au cœur de l’économie mondiale. Mais comme toute hégémonie, celle-ci n’est pas sans coût — en particulier pour les économies en développement d’Afrique. Des pays comme la Guinée, la Sierra Leone, le Sénégal, et une grande partie de la sous-région continuent d’opérer selon une logique « dollar d’abord » : les exportations sont libellées en dollars, les réserves sont détenues en dollars, et les dettes sont remboursées en dollars. Même les transactions transfrontalières les plus routinières doivent passer par le filtre du billet vert. Or, les vents financiers mondiaux sont en train de tourner — rapidement et de manière irréversible — dévoilant les fissures croissantes dans un ordre pétro-dollar autrefois inébranlable.
Des fissures dans l’ordre du pétro-dollar
Ce qui était autrefois impensable devient désormais réalité. Les grandes puissances commencent à remettre en question le monopole du dollar. La Russie et la Chine règlent désormais une grande partie de leur commerce énergétique en roubles et en yuans. L’Inde a repris ses transactions pétrolières avec l’Iran en dehors du système du dollar. Les pays membres des BRICS travaillent activement à la création d’une nouvelle monnaie de règlement adossée à l’or et aux devises nationales. Même des alliés traditionnels des États-Unis dans le Golfe, dont l’Arabie Saoudite, ont exprimé un intérêt croissant pour la facturation des contrats pétroliers dans d’autres monnaies. Il ne s’agit pas de simples hypothèses théoriques, mais de changements politiques concrets aux implications considérables.
Une enquête menée en 2024 par l’OAPEC (Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole) a révélé que plus de 50 % des acteurs du marché pétrolier anticipent une transition hors du dollar américain d’ici trois à cinq ans. Cette tendance témoigne d’une volonté délibérée et croissante de se prémunir contre la domination financière des États-Unis et les vulnérabilités géopolitiques qu’elle entraîne. Pour les économies africaines — fortement arrimées au commerce, aux réserves et à la dette en dollars — il s’agit à la fois d’un signal d’alerte et d’une occasion stratégique. Le risque ne réside pas dans une disparition soudaine du dollar (ce qui reste peu probable), mais dans le coût croissant d’une dépendance excessive à une seule devise dans un monde de plus en plus multipolaire sur le plan financier. Dans un tel contexte, cette dépendance n’est plus seulement inefficace : elle devient de plus en plus périlleuse.
Renforçant cette perspective, un rapport publié en janvier 2025 par le Center for China Analysis de l’Asia Society Policy Institute — rédigé par l’économiste Diana Choyleva — souligne que le système du pétro-dollar est en cours de redéfinition progressive sous l’effet des innovations financières de la Chine, notamment le yuan numérique et la plateforme transfrontalière mBridge. Ces systèmes de paiement alternatifs offrent des solutions attrayantes aux pays exportateurs de pétrole désireux d’accroître leur marge de manœuvre. Choyleva écrit : « Des forces convergentes pourraient accélérer les transformations du système financier fondé sur le dollar, au-delà des seuls bouleversements géopolitiques. » Tout en admettant que la dédollarisation totale du commerce pétrolier reste peu probable à court terme, elle prévoit une érosion progressive de la domination du dollar dans les règlements pétroliers et dans le recyclage des revenus pétroliers.
Choyleva esquisse trois trajectoires possibles :
Une évolution encadrée, avec une adoption progressive du yuan ;Un choc externe, provoqué par un conflit ou une percée technologique ;Un basculement rapide vers l’Asie, notamment si des États du Golfe comme l’Arabie Saoudite s’alignent plus fermement sur les systèmes chinois.
Chacun de ces scénarios véhicule le même message : l’ère du pétro-dollar n’est plus absolue — elle est en train d’être redéfinie en temps réel.
Pourquoi l’Afrique est vulnérable
Les vulnérabilités sont évidentes. Lorsque le dollar se renforce, les monnaies africaines s’effondrent souvent en conséquence. Le résultat ? Une flambée des prix à l’importation, des pressions inflationnistes accrues et des perturbations budgétaires. Des pays comme la Guinée et la Sierra Leone ont constaté une hausse vertigineuse des prix du carburant, du riz et des médicaments importés chaque fois que le dollar affiche sa puissance.
Pire encore, la liquidité du dollar est loin d’être garantie. Lors de chocs mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, les entreprises africaines ont eu d’énormes difficultés à accéder aux dollars nécessaires pour financer les importations vitales. Et lorsque la Réserve fédérale américaine relève ses taux d’intérêt — comme elle l’a fait ces dernières années — le coût du service de la dette libellée en dollars s’alourdit considérablement. Pour de nombreux gouvernements, cela se traduit par une ponction directe des ressources destinées à la santé, à l’éducation ou aux infrastructures. Pour les entreprises, cela menace leur solvabilité.
Il ne s’agit pas simplement d’une problématique macroéconomique. C’est une menace existentielle pour la stabilité nationale, pour la survie des petites et moyennes entreprises, et pour l’ensemble de la trajectoire de développement du continent.
Même Wall Street Diversifie ses Risques
Peut-être que le signe le plus révélateur du changement vient précisément de là où on s’y attendait le moins : Wall Street lui-même. En mars 2025, Morgan Stanley est devenue la première firme américaine à émettre des obligations Panda (Panda bonds), levant 2 milliards de yuans chinois (environ 279 millions de dollars) sur le marché domestique chinois. Parallèlement, Bloomberg rapporte que BlackRock, JPMorgan et Goldman Sachs diversifient discrètement leurs portefeuilles en investissant dans des obligations souveraines libellées en yuans, transférant des milliards vers le marché obligataire chinois pour profiter de sa stabilité et de sa pertinence croissante à l’échelle mondiale.
Comme l’a souligné la chroniqueuse financière Rana Foroohar, « Le dollar reste dominant, mais il est de plus en plus contourné. » Si les titans de la finance mondiale se repositionnent au-delà du dollar, la véritable question pour l’Afrique n’est plus de savoir si, mais quand.
Rompre avec l’habitude du dollar
Abandonner le dollar du jour au lendemain serait une démarche imprudente. Mais une diversification stratégique ? Elle est non seulement nécessaire, mais largement attendue. Les banques centrales africaines doivent prendre l’initiative en rééquilibrant leurs portefeuilles de réserves : il s’agit de réduire leur dépendance exclusive au dollar et d’augmenter leurs avoirs en or, en euros, en yuans et même en monnaies régionales. Des initiatives telles que le Programme de Coopération Monétaire Africaine (PCMA) doivent être relancées et renforcées.
Sur le plan commercial, les gouvernements doivent s’engager activement dans la conclusion d’accords de règlement en monnaies locales avec leurs partenaires régionaux et les puissances économiques émergentes. Le Système Panafricain de Paiement et de Règlement (PAPSS) — déjà opérationnel dans plusieurs pays de la CEDEAO — constitue une avancée majeure dans cette direction et mérite d’être étendu à l’ensemble du continent.
Le secteur privé a également un rôle clé à jouer. Les entreprises doivent développer leurs capacités en matière de gestion du risque de change : apprendre à se couvrir (hedging), à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et à négocier des contrats avec des options de règlement flexibles. L’adoption de monnaies électroniques, de portefeuilles numériques et de plateformes fintech locales contribuera à éloigner les transactions quotidiennes de la dépendance au dollar physique.
Mais surtout, l’Afrique doit user avec sagesse de son pouvoir de négociation lié aux matières premières. Pourquoi la Guinée devrait-elle libeller exclusivement sa bauxite en dollars alors que la Chine en est le principal acheteur ? Pourquoi le Sénégal ne pourrait-il pas négocier l’exportation de son huile d’arachide en francs CFA, en roubles russes ou en roupies indiennes ?
La souveraineté monétaire est un pouvoir économique.
La vérité fondamentale est la suivante : la dépendance monétaire engendre la vulnérabilité. Et dans bien des cas, elle équivaut à une forme de soumission. Lorsqu’un pays lie son destin économique aux décisions d’une banque centrale étrangère, sa souveraineté demeure incomplète. L’avenir de l’Afrique ne réside pas dans l’isolement, mais dans l’intégration régionale, la coopération monétaire et une refondation audacieuse des règles du jeu mondial.
Cela implique la construction de systèmes de paiement qui répondent aux intérêts africains, l’exigence de conditions commerciales plus équitables, et le refus catégorique de jouer le rôle de dommage collatéral dans les guerres monétaires internationales.
En somme, l’Afrique doit penser comme un bloc — et non comme une périphérie. Le dollar ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais sa suprématie n’est plus garantie. Les dirigeants africains et les entrepreneurs doivent lire les signes du temps. Ceux qui anticipent cette transition prospéreront. Ceux qui s’y refusent risquent d’être gravement exposés — lorsque la marée du dollar commencera inévitablement à refluer.
Par Thierno Mohamadou Diallo, enseignant-Chercheur, Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry