Cette tribune intitulée:« Délogés au nom du développement : un cri de justice venu de Dounet », attire l’attention de l’opinion publique sur les conséquences humaines souvent ignorées des projets d’infrastructure routière en Guinée, en particulier dans les zones rurales. Il plaide en faveur d’un développement plus inclusif, respectueux des droits des populations locales, et appelle à une gouvernance plus transparente et équitable.
Bonne lecture !
En Guinée, le développement des infrastructures routières est devenu un secteur florissant, largement dominé par des entreprises chinoises. Ces projets de grande envergure sont souvent présentés comme les symboles du progrès et de la modernisation économique. Pourtant, derrière les routes fraîchement bitumées se cache une réalité bien plus sombre : le coût humain dévastateur que supportent les communautés locales. Les termes de ces contrats, généralement dissimulés au public, semblent favoriser les entrepreneurs étrangers tout en négligeant les droits, la dignité et le bien-être des populations concernées.
Parmi les nombreuses communautés touchées figure celle de Dounet, située dans la préfecture de Mamou, au cœur de la Moyenne-Guinée. Dans le cadre d’un projet national d’élargissement de routes, des habitations ont été détruites, des familles déplacées, et ce, sans consultation préalable ni indemnisation adéquate. Ces familles—composées essentiellement de petits exploitants agricoles—se retrouvent sans abri, appauvries et désabusées. Exclues des processus de planification et de prise de décision, elles n’ont reçu que des réparations dérisoires, tardives et incomplètes.
Et ce cas est loin d’être isolé. Partout en Guinée—des zones côtières animées de Conakry aux montagnes forestières reculées du Fouta Djalon—des récits similaires se répètent. À Kouroussa, par exemple, les résidents vivant le long des nouvelles autoroutes et ponts n’ont reçu que de maigres compensations, totalement insuffisantes pour reconstruire leurs vies. Comme à Dounet, ce sont les mêmes entreprises chinoises qui ont été mobilisées, avec des résultats tout aussi préoccupants : infrastructures de piètre qualité, matériaux médiocres, et mépris flagrant pour la sécurité des communautés. Au lieu de renforcer les canaux de drainage existants, ceux-ci ont été obstrués, provoquant des inondations destructrices et le déplacement de nouvelles familles.
À Conakry, capitale en pleine expansion, des entreprises chinoises ont été chargées de réhabiliter le réseau routier. Pourtant, quelques années après l’achèvement des travaux, de nombreuses routes montraient déjà des signes avancés de dégradation, jonchées de nids-de-poule et de fissures structurelles. En zone rurale, la situation est encore plus alarmante : réduction des coûts, matériaux de mauvaise qualité, absence de dispositifs de sécurité essentiels tels que les systèmes de drainage. Ce sont, une fois de plus, les citoyens les plus vulnérables qui en subissent les conséquences, sans moyens de recours ni accès à la justice.
Le coût humain de cette négligence est tragiquement illustré par l’histoire de ma tante, une femme aveugle de 90 ans vivant à Dounet. Sa modeste maison a été gravement endommagée lors du projet d’élargissement de la route. Ci-dessous figure un ensemble d’images montrant certains des bâtiments affectés, la route, les caniveaux de drainage, ainsi que la maison de ma tante, qui n’a été que partiellement réparée afin de lui permettre de rester sur place et d’éviter son déplacement. Outre la démolition partielle de son domicile, les entrepreneurs ont bloqué un canal naturel de drainage à proximité. Depuis, sa maison est régulièrement inondée, rendant la vie quotidienne pratiquement insupportable. Bien que la Chinese Road and Bridge Corporation (CRBC) ait promis une compensation, le montant offert était lamentablement insuffisant. À ce jour, sa demeure reste en ruine, et elle est prise en charge par l’une de ses filles, elle-même plongée dans une grande précarité. Comme l’a souligné l’économiste du développement Amartya Sen : « La pauvreté n’est pas seulement un manque de revenus. C’est l’absence de capacité à mener une vie digne. »
La route elle-même, construite par CRBC, constitue toujours un grave danger public. De profonds fossés non protégés bordent chaque côté de la chaussée, mettant en péril les enfants, les personnes âgées et les piétons. Les accidents sont devenus quotidiens à Dounet. Une autre inquiétude majeure est la recrudescence du trafic à grande vitesse dans la traversée du village, notamment des véhicules se rendant vers la Haute-Guinée. Récemment, deux accidents mortels se sont produits le même jour : un Imam local a été percuté et tué alors qu’il traversait près de la station-service du village ; dans l’autre cas, un jeune conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie du village et est mort sur le coup. Malgré ces drames, aucune mesure significative n’a été prise, et aucune responsabilité n’a été attribuée aux entrepreneurs à l’origine de ces infrastructures défectueuses.
Face à ces dangers persistants, les autorités locales ont soumis une demande auprès de la Direction Nationale des Routes—par le biais du bureau régional de Mamou—pour installer au moins six ralentisseurs dans les zones sensibles de la commune. La demande a été rejetée. La réponse officielle évoquait l’inachèvement du projet routier comme motif du refus. Mais combien de temps la communauté devra-t-elle attendre ? Et combien de vies supplémentaires devront être sacrifiées avant que des mesures de sécurité élémentaires ne soient mises en œuvre ?
La situation guinéenne s’inscrit dans une tendance plus large à travers l’Afrique. En Zambie, au Kenya, au Zimbabwe et ailleurs, les projets d’infrastructure dirigés par les Chinois ont suscité des critiques similaires : travaux de mauvaise qualité, manque de transparence, et indifférence aux besoins locaux. En Zambie, des routes construites par ces mêmes entreprises se sont rapidement détériorées en raison d’un drainage inefficace et de techniques de construction inadéquates. Les communautés se retrouvent avec des infrastructures défaillantes, tandis que les bénéfices échappent au pays. Comme le note le prix Nobel Joseph Stiglitz : « Le développement ne devrait pas être quelque chose qu’on fait aux gens, mais quelque chose qu’on fait avec eux et pour eux. »
La corruption et la mauvaise gouvernance aggravent encore les choses. En Guinée, comme dans bien d’autres pays africains, des fonds d’indemnisation ont été détournés par des responsables locaux. Dans plusieurs cas, seule une fraction des montants prévus est parvenue aux bénéficiaires. Les communautés, déjà fragilisées, se retrouvent encore plus appauvries—privées à la fois de leurs biens et de l’aide promise.
Face à ces injustices persistantes, il est clair que le modèle actuel de développement—alimenté par des contrats opaques et une supervision institutionnelle faible—échoue à servir ceux qu’il est censé aider. Si le développement des infrastructures est essentiel, il ne doit jamais se faire au détriment de la dignité humaine et de la justice sociale. Le gouvernement guinéen doit agir avec fermeté pour garantir la transparence dans l’exécution des contrats, la qualité des travaux et l’équité dans les indemnisations. Surtout, il doit associer les communautés locales à toutes les étapes du processus de développement.
Comme l’a averti l’économiste et philosophe Albert Hirschman : « La seule manière de changer les choses est de le faire avec les gens, et non à leur place. » Un développement qui déplace, réduit au silence ou appauvrit ses bénéficiaires n’est pas un développement.
Les habitants de Dounet—et tant d’autres à travers la Guinée et le continent africain—méritent mieux. Il est temps d’engager une véritable introspection nationale. Le gouvernement doit prioriser les mesures de sécurité, garantir la transparence dans les travaux publics, et reconnaître que le progrès authentique commence par l’inclusion de ceux qui sont le plus touchés. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons affirmer construire non seulement des routes, mais aussi un avenir plus juste et plus humain.
Par Thierno Mohamadou Diallo, enseignant-Chercheur, Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry
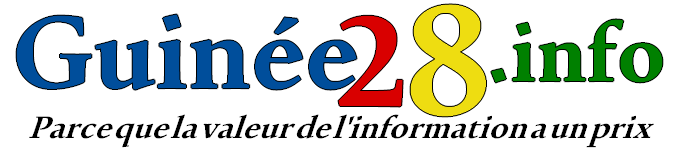

![Délogés au nom du développement : un cri de justice venu de Dounet [ Par Thierno Mohamadou Diallo]](https://guinee28.info/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-05-at-16.28.24-1024x1024.jpeg)